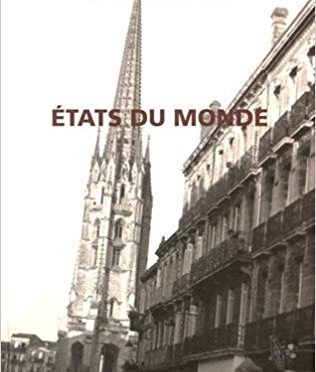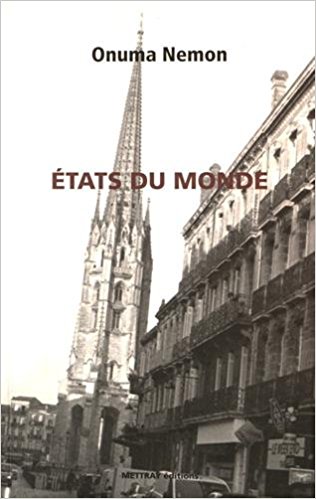
Voici bientôt dix mois que le dernier opus de Onuma Nemon, États du monde, a été publié par les Éditions Mettray.
Après donc presque une année de lecture menée parallèlement à d’autres lectures du moment, mon exploration de cet Everest scriptural se poursuit.
À chaque reprise de l’ouvrage se répète l’expérience déjà vécue lors d’immersions similaires dans les œuvres de Sollers, Joyce, Céline, Pound ou même Gatti …
Chaque fois j’en éprouve une vraie joie – disparaître dans la forme déraisonnable d’une entreprise artistique vitaliste fondée sur le réel et sa perméabilité au rêve.
Intuition du vide – Le temps n’existe pas.
Atemporalité du vide –
Écrire (lire) lentement – suivre les traits des marges spatiales qui fixent parfaitement les territoires de l’Aïon et du Kairos.
Tout peut être embrassé – il faut une cime – les crêtes et les à-pics sont nombreux.
Mais franchir d’abord un pont étroit au volant de la Chrysler rouge du premier narrateur, en pariant passer l’ouvrage de nuit et à toute allure, tous feux éteints, en équilibre, presque porté par l’air qui s’engouffre sous le châssis, en quasi apesanteur dans l’habitacle, sourd au hurlement du moteur, le regard fixé sur la bande de roulement et les lignes parallèles du parapet qui dessinent la rampe de lancement, d’emportement.
Seule l’action compte, ses instantanés – la chaleur des frottements, des oscillations.
Plaisirs d’enjambements, de survols (pour ce faire, le lâcher prise est bien sûr recommandé) ou descente quasi spéléologique dans la multiplicité des sens.
Et tant pis si l’érudition de l’auteur lézarde fréquemment l’épaisseur du rêve.
Pour suivre l’écrivain, il nous faut agir avec lui – mot à mot parfois sinon rien n’est possible.
L’acte véritable est donc bien de le suivre. Les impressions ressenties seront autant d’instants primordiaux qui prolongeront la jouissance de notre entêtement à affronter la somme de réalité(s) contenue dans les États du monde, ce « feuilleté de signifiance », parce que la part du réel y est étourdissante, et qu’elle dérange l’idée que nous nous faisons du monde et des trajets humains.
Le saut est fait. Nous sommes du franchissement, dans l’inconfort du voyage.
Au rythme de la lecture, des kilomètres avalés, le volume se déplie, étale ses cartes, déploie ses mondes – villes, quartiers, prairies, forêts, lacs, fleuves, taïga, toundra, mers, grandes prairies, fleurs, animaux, continents textuels etc. -, montre ses multiples figures, présente ses corps.
Je veux dire que les franchissements sont nombreux, et que des cartes existent, mais que par son inscription – en dévoilant ses contours, ses bords; en formulant ex abrupto les instants comme un peintre le ferait sur sa toile, soulignant, cernant les vides où se forment des constellations par ses inventions typographiques et autres propositions graphiques -, la forme créée dépasse la littérature et toutes les actions, les instants mêmes qu’elle relate et qui sont des mondes à eux seuls.
« Mais ce que je voulais te dire au début, Louis, mon idée de départ, dans l’écriture, c’était d’arriver à un dehors du récit, à une sorte d’anachronisme parfaitement emboîté. »
Il y a donc ce que O.N en dit et qui éclaire partiellement la recherche, et ce qui ne l’est pas et qu’il faut essayer de débusquer en s’en référant aux « images », aux autres « traces » de l’inscription, voire à des pistes dont les correspondances se retrouvent dans les vocables eux-mêmes, Pierres de rêves indiquant que le sens est aussi un vortex oraculaire ou méditatif et qu’il n’y est pas question de dire le temps ou la situation autrement qu’en y provoquant une distorsion du réel et l’accélération des enchevêtrements spirituels qui s’y produisent.
Je crois en outre qu’il faut accepter que le rapport entre les différentes narrations ou les personnages entre eux, entre les espace-temps et les multiples destins qui les traversent puisse être aussi ténu parfois; subtil, de l’épaisseur d’un trait, au fil des portraits ou des partitions du chant.
Il est également possible après tout qu’une nécessité occulte propre à l’auteur préside à l’existence et donc à la nature même de cette liaison laquelle associe aux Voix agissantes les forces naturelles élémentaires elles-mêmes, les lieux, les hommes et les Dieux. J’ai retrouvé d’ailleurs dans le chapitre intitulé À propos de Pouchu. Octobre 1945, un dieu Kon « dieu sans nerfs ni articulations » qui « réunit les territoires en leur donnant un sens lié, relié …/ »
Il y a aussi dans l’idée des Voix, l’idée d’enregistrer leurs vibratos, l’intention d’en sauvegarder impérativement l’ampleur des graves et des aigus, les silences et les durées de débordement comme une preuve de vie.
Bien que la langue soit avant tout une énonciation du corps dans le souffle, le corps donne aussi aux mots (à des mots) valeur de de trace(s).
Doit-on cependant en déduire que l’écriture ici rêve le corps comme le monde ? Évidemment non.
L’écriture résulte d’un acte de haute et pleine conscience dont les tracés attestent quelquefois qu’elle peut être le lieu où les mots et la vie entrent réellement en interférence. Elle procède véritablement du balancement constant de l’ombre dans la lumière, de la danse de l’infamie avec l’amour, du Tango d’Apophis avec Mnémosyne sur le parquet de bal de notre gyrus angulaire.
Il s’ensuit que la poésie danse immobilement bien au-delà de la marque de la lettre, du marquage de l’esprit par la lettre. Ainsi l’avancée, la progression, semble se faire dans une mémoire qui s’en/visage en unités-lumière, le rêve-temps du Pays des rêves apparaissant, non dans le bois chantourné d’un vieux mythe d’écrivain, mais plutôt dans la présence d’esprits, dans le mouvement et l’esprit même des objets, des hommes, des espaces ou topos du monde porté par O.N et qui le porte.
Parcourir les lignes des États du monde, c’est explorer le tracé d’un spectrogramme révélateur en somme d’un espace-temps sonore déterminé qui entre en résonance avec notre propre sensorialité. C’est réceptionner la polyphonie Nemonienne comme un espace d’interférences entre oralité et écriture -géométrie et algèbre-, entre la trace et la parole; un lieu d’interaction aussi entre le scripteur et le lecteur.
« ON NE PEUT VIVRE avec les Morts, mais on ne peut vivre non plus sans eux. » Parce que les morts comme les vivants n’appartiennent pas au passé lequel, à défaut d’être une imposture, reste une illusion, tous les corps (morts ou vivants) sont du présent. Et le Voyage au pays des morts est la reprise, à mon sens, d’une discussion avec des êtres chers qu’une instance protoplasmique transporte en permanence. Là, ce sont encore les voix qui appartiennent au narrateur, au texte, ainsi qu’aux autres protagonistes appartenant à cette singulière « unité de mémoire » objectivée dans ce Chant pluriel, qui agissent sur l’instant suspendu où tout commencement devient, redevient possible. C’est bien ainsi, au sein même de la parole – la sienne /les siennes, les nôtres – que s’opèrent les mutations, la dérive des continents, des îles (je/tu/il – nous/vous/ils) ou des durées. Cet avertissement adressé au lecteur à propos de Louis de Verteillac nous informe très clairement : « Il suffisait que je m’endorme près de la radio en la laissant ouverte sur une fréquence secrète de radio-amateurs, pour qu’à un moment donné l’irruption se fasse ; et l’avalanche des Voix se déclenchait, se mêlant à mon rêve, tandis que je circulais au milieu d’elles. Je vous les laisserai désormais entendre comme elles surgissent. »
Il n’en reste pas moins vrai que c’est tout de même parfois compliqué de maintenir le cap.
Sans que l’on en ait vraiment pris conscience, on finit par s’égarer, flottant dans ce qui ressemble à une géométrie elliptique ou hyperbolique du récit selon que les motifs de l’itinérance mémorielle se recoupent, et de manière coïncidente se confondent momentanément en une seule histoire, ou que quelques réalités parallèles en viennent à se croiser à un même endroit éclairant d’une lumière stupéfiante une intersection narrative dont on ne sait cependant si elle nous permettra de poursuivre l’expérience sensualiste avec le même degré d’intensité éprouvé jusque-là ou de poursuivre tout court.
« Pas de sermon ! Le passage ! » rien que le passage, et le périple se fera (entre autres univers) à travers les mystères d’Eleusis ou le Jardin des délices ; il ne s’agit là bien sûr que d’une interprétation toute personnelle.
À la paix succédera la guerre. L’existence est souvent faite de merde où les fleurs puisent force et beauté. Le sexe et la mort y sont étroitement et fantasmatiquement liés.
Car dans cette recherche, le Cul est un creuset alchimique, l’endroit sublime des fumets de campagnes, le seul vrai cadran humide et chaud aux humeurs délicieusement ammoniaquées et hydrogénées de l’horloge universelle. Les arbres sont des corps, mais oui, et les corps déchirés, lorsqu’ils sont vus, portent la tête d’Orphée. Quant au champ lexical lui-même, il est un étamoir où le fer à souder du Maître verrier fait fondre le métal sous l’égide de Saturne.
Enfin, c’est ce qu’il me plait à croire lorsque je marche dans ce labyrinthe textuel et que je fais abstraction de ce qui s’efface provisoirement des histoires relatées – les pages lues n’en demeurant pas moins présentes – à mesure de l’assemblage des chapitres tels des calibres de verre entourés par l’âme et les ailes du plomb.
Car les États du monde sont composés par les pièces d’un immense vitrail cervical où les étincellements, la scintillation provoqués par le flux, les décharges émotionnelles, les informations, les pensées qui le parcourent en dévoilent le réseau nerveux, électrique.
Pas de fiction, de philosophie etc., mais par touches épaisses, directes, par vides – tantôt aussi terribles que froids -, de la pure poésie, dure parfois comme la terre gelée de Kolyma.
Du réel, rien que du réel ! comme des coups de feu, mais aussi le « (chemin suivi en débarquant dans le rêve) »… et toujours « autre chose que le discours indirect. »
C’est le mélange de ces deux drogues dures (réel et rêve imbriqués) qu’affectionnent les multiples narrateurs des États du monde dont Bordeaux semble être l’historique plaque tournante du trafic mnémique, mais encore : Paris, Bruges, Auch, Tours, Varykino, Buenos Aires, New-York, … et j’en passe.
Je (comme le récit ou le temps) n’existe pas. « Quand on descend, la montée a disparu (les deux sens ne coexistent pas) » Seul le mouvement, l’exact pétrissage que la réalité de la vie impose aux êtres, inquiète puis fixe le regard.
C’est à la fois simple et difficile, complexe ; comme dans toute grande œuvre.
Énigme sur démesure – Cheminement, processus évident – Le corps et sa mémoire – Principe essentiel – Adéquation à l’instant.
Les humains, leur génie et leurs bassesses, brillent et s’éteignent comme les instants dans la boue des tranchées, sous les corps impudiques des Ménades, dans les rues des quartiers prolétaires, la turpitude et l’horreur des Camps, lors de moissons solaires ou mélancoliques, dans un jardin potager, sur un adret parmi les hauts sapins, dans un atelier de mécanique automobile ou une arrière-boutique. Les bêtes font bien sûr partie du troupeau. Les choses trimbalent des époques, lesquelles évoquent muettement leurs usages.
Le monde est silencieux et assourdissant comme dans un film de Jean-Daniel Pollet.
Et puis partout les odeurs ! Odeur de « l’herbe tranchée » « palpitations en cadences folles …/… sur des orchidées, jacinthes, pivoines de Chine à odeur de rose, les iris parme, les hautes jonquilles » et toujours la surprise de les voir, comme si on y était, graciles sur leur pied vert d’eau.
Effluves vaseux des marées – lumière
Puanteur des béances – lumière
Haleines – fleuves – jardins
Cloaques, mais la lumière encore
–
Horreurs comme merveilles – Équinoxes, par vagues spirales
Somme d’ex-voto, de promesses ?
–
Derrière le langage il y a la puissance
d’un œil-langage
un corps-delta, un trou de conscience.
–
Qu’importe son nom – sans nom.
Il y aura toujours quelqu’un pour que le rêve et le vide soient portés à nouveau.
–
R.N