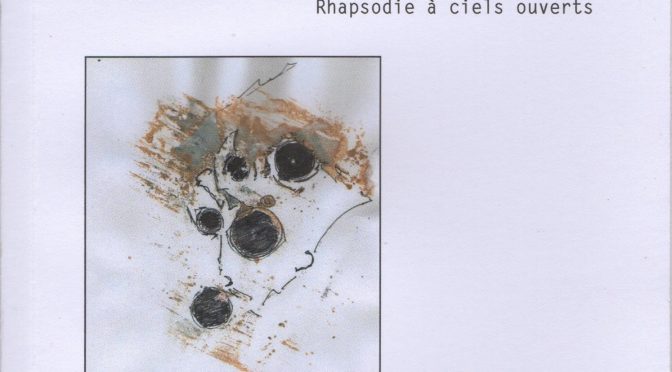« Dans la rencontre amoureuse, je rebondis sans cesse, je suis léger. »
Roland Barthes – Fragments d’un discours amoureux
« L’eau parle sans cesse et jamais ne se répète. »
Octavio Paz – Liberté sur parole
SANS CESSE –
Petite introduction
Pour reprendre un peu les termes de la présentation que j’avais adressée à Jean-Claude Goiri lors de nos premiers contacts, je crois qu’il faut admettre cette prose poétique comme une sorte de prière athée ou profane qui par sa construction anarchique peut aussi ressembler il est vrai à une proposition libertaire.
SANS CESSE est un texte vitaliste (que je revendique comme tel) tissant dans ses lignes les signes et les images d’une espérance dégagée de toute morale moralisante. C’est un texte doux et fort à la fois qui colle pas mal, par certains de ses aspects, aux questionnements de notre époque, mais dont l’intérêt principal réside, me semble-t-il, dans son désir adolescent de déchirer le voile d’une réalité dont on nous prie de croire par tous les moyens ou presque quelle serait ainsi, avec toutes ses fictions, à prendre ou à laisser. Le hasard qui d’ailleurs traverse souvent le chant apparaît comme une réciprocité à la nécessité, aujourd’hui plus que jamais, de croire aux forces de la vie.
S’il n’y a dans ce texte aucune autre organisation que celle que le rêve et la spirale de l’ammonite mettent à la disposition de chacun de nous, SANS CESSE n’est pas pour autant un simple récit onirique. Bien entendu, de multiples lectures sont possibles. On peut très bien l’interpréter par exemple comme étant un regard posé sur le/les temps, où la poésie et la sensualité -parfois déclinées au deuxième degré- forment la trame d’une narration dans laquelle on est en mesure de reconnaitre les séquences d’une histoire quelque peu autobiographique faite d’expériences, d’apparitions et de rencontres au sens de « synchronicités » merveilleuses où le hasard, la mémoire et donc le rêve tiennent une place prépondérante.
Miguel Angel Real qui a choisi d’en présenter des extraits dans la revue mexicaine La Piraña l’a compris avec beaucoup d’intuition. Si l’on en juge par les passages que le poète a sélectionnés pour les traduire en espagnol, on devine que son intérêt se porte sur ce que recèle ce texte quant aux questionnements relatifs à l’écriture, à la parole et aux méandres du dire qui prennent source dans les strates profondes de l’intime, et ne servent pas seulement à raconter une histoire. Il est vrai que les trois-quarts du récit proposés sous la forme d’un monologue intérieur, où le je et le tu établissent une sorte d’ambiguïté, posent la problématique de qui suis-je, qui parle et depuis quel lieu, mais aussi de l’isolement, de l’internement consenti de celui qui écrit depuis sa cellule et ne cesse de l’habiter comme une sorte d’aveu, ainsi que l’évoque la postface de Onuma Nemon. Ce qui par ailleurs n’empêche en rien la parole de s’en extraire trouvant naturellement la plupart du temps son accomplissement dans sa relation au vivant, et par conséquent, effectuant son rôle de transmettrice de signification qui lie le chant à la propre existence du narrateur, à sa corporéité, mais aussi à son rapport (critique) avec lui-même, avec le monde et le cosmos.
Nous nous construisons tous une histoire qu’il est nécessaire de réinventer en permanence en la faisant vivre, revivre, en la prolongeant sans cesse tout en rebattant les cartes du rêve, et en rehaussant les voix qui par le passé nous ont pourtant déjà beaucoup dit, mais encore pas assez, tant on perçoit par leurs échos qui parfois arrivent jusqu’à nous, et fugitivement nous traversent, qu’elles nous manquent et nous hantent continuellement.
Par le langage, c’est une part de l’inconscient qui pilote. Je n’invente rien. C’est Lacan qui le dit (mieux que moi). Mais si l’on excepte la poésie minimaliste, on sait bien que l’inscription ne cède jamais trop de terrain à l’indicible dénué de toute intention et en face duquel, de toute façon, la parole finit par s’éteindre.
Toute inscription installe – énonce – donc le réel à sa façon, et occupe une temporalité anamorphique qui est la seule temporalité peut-être finalement qui vaille la peine d’être relatée.
Car dans une histoire – eût-elle été sommairement inscrite dans l’écorce d’un tronc d’arbre par la pointe d’un couteau -, ce sont bien les réminiscences qui, à travers la profusion des réflecteurs mémoriels, provoquent le geste du dire et par conséquent ce qui se manifeste dans le poème, la danse, le tableau, la photo, dans l’intonation du chant, etc. Tout comme elles provoquent le surgissement des présences, lesquelles peu à peu s’inscrivent au rythme des turbulences langagières dans l’énoncé de celui ou celle qui exprime à sa manière ce qui peuple son dire, circule en son sang, et parfois s’en défait.
Ainsi dégagé des contraintes comme des fictions, le dit se déliant de mémoires oubliées peut être alors au plus près du geste, libre de toute obligation esthétique ou de quelque autre principe.
Je ne sais pas, au fond, si la « gestuelle » de SANS CESSE aura pu m’aider à me défaire des mémoires oubliées dont mon organisme pourrait avoir gardé traces. J’en doute. Si écrire est pour moi (comme pour nombre de mes semblables) une nécessité et une épreuve, cette pratique de cinglé ne résoudra probablement jamais totalement (pour ce qui me concerne) les traumas enfouis. Même si par endroits il y a eu des failles, et donc de profondes plongées, et que le dire a tournoyé au-dessus de l’Insula.
Pour le reste, ce que l’on appelle communément le style – la manifestation presque physique du dire, sa danse -, je crois tout de même qu’un chant parvient à s’en dégager. Mais c’est un chant d’asthmatique qui s’inscrit dans un tissu de fortes activités émotionnelles ; un lieu où souffle et dit girent, se débordent mutuellement et s’arrogent le droit de se perdre comme de faire perdre à une lecture le fil de « l’histoire ». C’est désordonné, parfois presque non-verbal et par conséquent quasi-musical, comme dans la vie ; je veux dire accompagné d’une bande-son et image profuse.
Rien à voir hélas, avec l’écriture de conscience, simple et forte, à la fois rassurante et inquiétante au sens d’un mouvement, d’une oscillation de l’être, corps et âme en équilibre constant dans la réalité du monde, que l’on rencontre par exemple chez Didier Ober, un poète Creusois que j’ai découvert dans la remuante revue Traction-Brabant.
On aime d’emblée son écriture parce qu’on la sent proche de nous, et qu’elle touche une part de l’intime, une part de notre conscience la plus profonde qui est en relation avec le cosmos. On lit sa poésie, et on est immédiatement embarqué, comme lorsqu’on fait rouler une pierre dans nos doigts, et que, par le simple fait d’observer le minéral, notre esprit s’échappe et nous éloigne subtilement des fictions ou des passions qui nous empoisonnent et nous emprisonnent. C’est simple et beau.
Pour essayer d’être complet, je dois ajouter que SANS CESSE s’est construit pour partie au cours de ces dernières années au rythme de la publication de plusieurs recueils dans la Collection Encres Blanches des Editions Encres Vives dirigées par Michel Cosem.
Le principe : écrire dans un bloc-notes initialement intitulé Dormir le temps des « épisodes » ou « chapitres » qui seront immanquablement réécrits à « plusieurs voix », et s’engouffreront dans une infinie spirale de mondes, de textes (quelques fois détruits) et d’évènements (vécus de près ou de loin) aux correspondances réciproques. Ce sont eux qui accueilleront les toutes premières versions d’une prose réinventant en permanence le chant et ses métamorphoses qui circulent dans le sang d’un narrateur pluriel.
Ni discours ni mimique littéraire, mais une libre itinérance, une rhapsodie – au sens musical du terme – de solitudes, de coïncidences etc. qui interrompent parfois le banal cours des choses – la chronologie -, et rendent brusquement la réalité effrayante, sinistre ou merveilleuse.
Des exigences cependant : aucune rhétorique codée, et que la prééminence du chant comme de l’écrit ne cède pas au lisible. À ce titre, l’indéfectible soutien de Michel Cosem à l’égard des poètes – et par conséquent à l’égard de la critique et des alertes que propose encore la poésie – est inestimable. Terre-à-terre fut publié en 2017 chez EV grâce à l’esprit d’ouverture de cet homme. C’est formidable. Je pense que personne d’autre n’aurait consenti à publier ce texte énumératif des espèces animales et des biotopes menacés de disparition. Terre-à-terre est peut-être d’ailleurs le dernier chapitre en date d’un livre qui aura toujours été davantage rêvé qu’il ne fut souhaité fini. Je ne retins pas ce « chapitre » pour SANS CESSE, mais sa présence enrichira très certainement de futures propositions.
Le manuscrit personnel aura compté jusqu’à deux cents pages.
Pour certains éditeurs, l’ensemble était trop volumineux. Pour d’autres, c’était la nature-même du texte qu’ils jugeaient inclassable. Quelques revues cependant ont signalé le texte, comme la revue Secousse des Editions Obsidiane par l’intermédiaire de Christine Bonduelle et François Boddaert.
Nous sommes en 2016. J’affronte un Cancer, et Jean-Claude Goiri me fait part de sa volonté de publier mon chant dans sa totalité.
Durant plusieurs mois le manuscrit est alors passé au crible. Des pans entiers sont élagués, dégrossis, corrigés, mais avec la ferme intention de ne réduire du texte aucun de ses à-pics, de n’en gommer aucunes brisures ni d’en blanchir le plus petit de ses psaumes.
Sa disposition « finale » se réalisera à l’occasion d’un pur jaillissement, d’une nécessité de proposer le début d’une réponse à – qui suis-je ou qui es-tu ? – correspondant au chapitre IV lequel, à mon sens, pouvait permettre à l’ensemble de tenir.
SANS CESSE s’est véritablement organisé à ce moment-là.
Ça chuchote partout et un peu dans tous les sens, mais il n’y est jamais question de répondre à la violence ou au mépris autrement que par un hymne à la joie, à l’ardeur spirituelle.
Patrice Maltaverne, le poète du réel, auteur de nombreux recueils, dira : « Ce qui est montré ici, c’est l’amour de la liberté et de la vie, la beauté des paysages, le désir des corps, bref, le côté solaire des choses…Une poésie de la lucidité également, envers et contre tout. »
Immense compliment.
SANS CESSE est une errance qui n’en aura probablement jamais fini avec ses paysages.
Comme toute errance, elle ne s’inscrira jamais dans le sillage de ce qui se dit (doit se dire ou doit se faire). Elle est remplie et se nourrit d’un joyeux foutoir qui se moque pas mal des systèmes qui font de nous des cooptés ou de très discrets locataires du rêve.
Quoi qu’il en soit, elle restera ouverte à tous les vents, à tous les sens ; ancrée dans la parole, l’expression même de la vie.
« Sous mon diaphragme, je porte un vieil enfant qui suce à longueur de temps ses longs cheveux. Je suis incompréhensible. Et curieusement tous mes proches me reconnaissent, et accordent simplicité à mon langage quand je ne suis qu’à la tête d’un cortège de fictions. »
G.V
Article paru dans la rubrique L’établi du FPM sur le site des Editions Tarmac