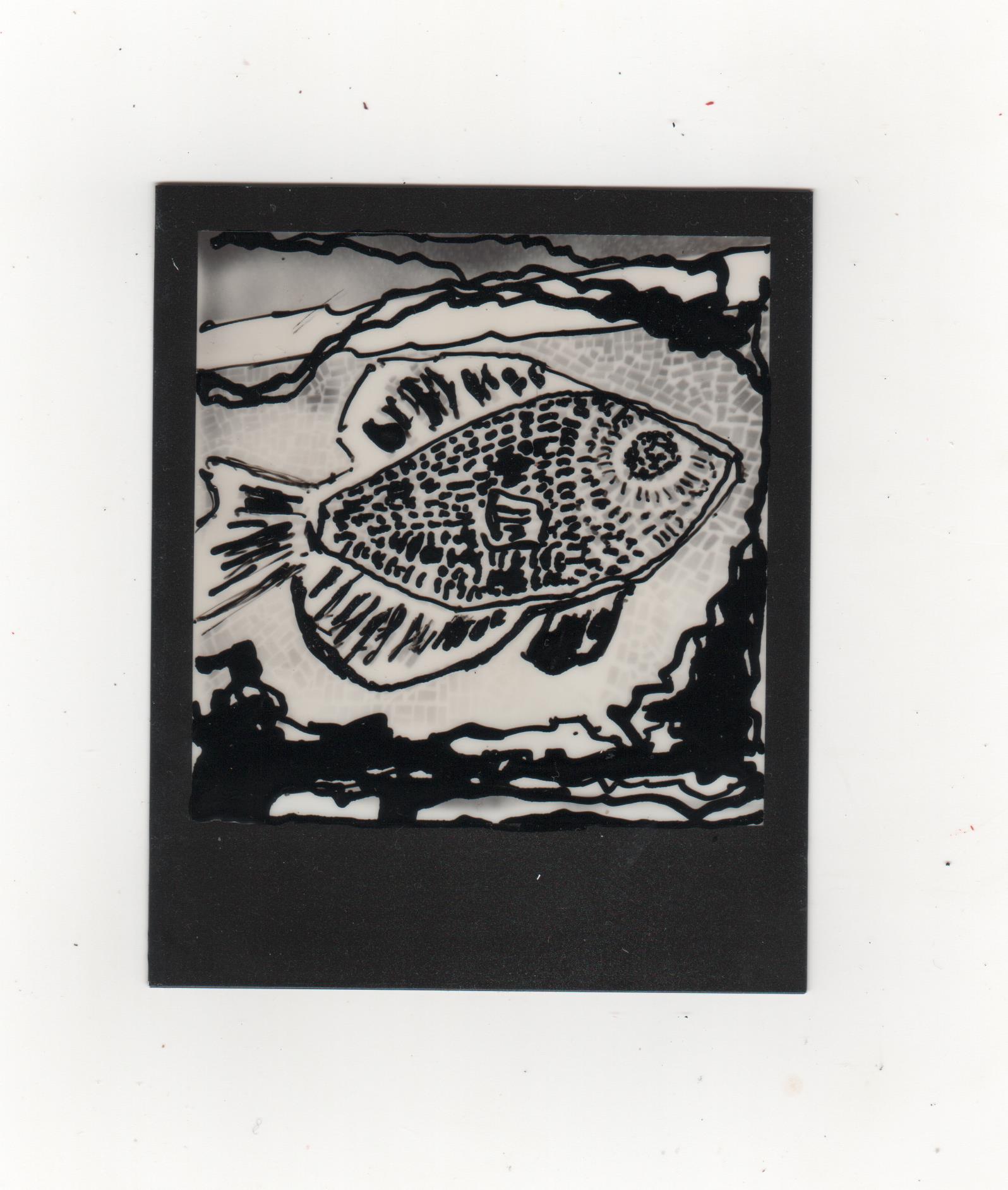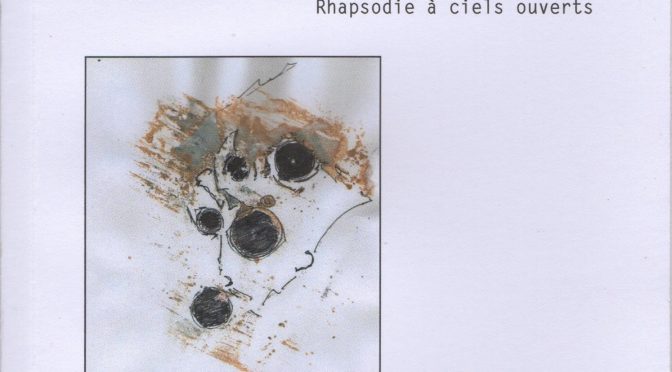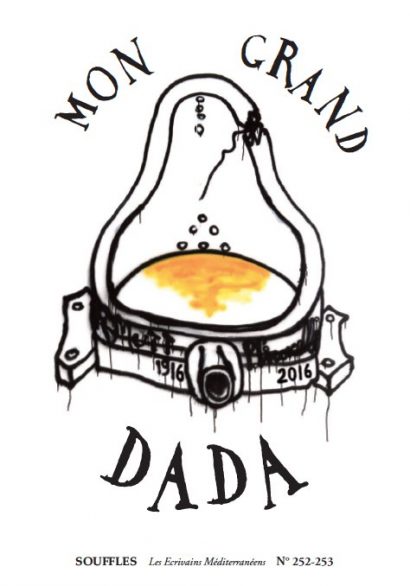Ainsi dessaisit tout aussi, mensonge comme vérité ; déroute, épuise, aère, enthousiasme ou obture la pensée, épanouit ou éreinte les corps, infiniment. Jouons-y le jeu des va-et-vient de l’esprit et des corps. Aimons-nous ! traversons le temps dans l’aura de la musique et les luminescences du rêve.
Écoute seulement. Aveuglément.
Ainsi peut bien oublier constamment ses mues d’Ios – rouilles négligemment abandonnées –, et tenir aujourd’hui la gare de triage et le port (ses attroupements de grévistes) dans une durée énigmatique à la porte de l’inconnu que l’on ne passe qu’en vousoyant l’orée, l’oscillation du présent y est sublime.
Entre désordre → (phénomènes) et harmonie, plusieurs temps existent dont il est impossible d’effacer les traces. Qu’il en soit Ainsi avec son aplomb ordinaire qui se confond ici dans les eaux vertes de l’embouchure et les vagues sur la digue écrasées, dispersées en milliers de gouttelettes, en petits miroirs disséminés par le vent dans les fossés de prose et de rosée, comme par-dessus les flancs rouillés des bateaux – pour certains chargés de voitures européennes, japonaises ou coréennes – alourdis pour d’autres par des quantités de bois ou de ferraille.
Ainsi ne cherche pas à en savoir davantage. N’a jamais cherché non plus quelle curieuse parenthèse créatrice, quel processus, fit du corps notre étroit et inconfortable scaphandre. Ainsi fomente les formes, le sacrum de sa langue – le goût et le sexe –, plonge ses vertèbres dans le fracas hétéroclite de couleurs phénoménales, lâche des corps plus vrais que nature, les précipitant sur la matière même des choses, et laisse sans arrêt l’espace tomber.
In sic, voici mes moires qui dansent, nobles et rouées. Comme auront été bons vos yeux, d’abord sévères, puis attendris, portés sur les nôtres menacés par la chute, le rétrécissement du vide, l’occultation des signes.
Entre l’Euphrate et le Tigre, comme au sortir d’un anéantissement (Abu Ghraib de l’éden ; l’horreur des cages, des coups de trique, des corps rendus inhumains et des chiens démons) même si elle n’est rien que le souffle d’un sac de poussière, – cette poix sèche crachée, arrachée avec son tapioca glaireux qui obstrue de nuit les bronches, et qui s’accroche ensuite aux parois du pharynx, avant que les mots ne s’échouent disloqués vers la bouche carte du monde et du soleil ; bouche si désœuvrée et tellement ensuquée par le vide et la peur, par la boue léthargique du dernier sommeil, qu’il lui faut d’abord épeler un juron, – la parole veut encore s’étoiler et déborder ses ruines leur ajustant des lés de ciels extravagants !
L’air bouge dans un signe très ancien que des effluves d’asphalte et le goût délicieux de mes cigarettes espagnoles embaument. À peine un éclat, un vague balancement, et c’est la totalité des choses qui fond sur l’arrière de la langue. Aujourd’hui est la mère, la permanence d’Ainsi.
Une pituite pleine d’une infinité d’images du monde ferme mes yeux sur le souvenir flottant du voyage ; la neige, les plages, et ces lueurs sur la peau de l’onde que les notes de Little Wing accompagnent, jusqu’à la maraude inconsciente des aurores entichées d’extraordinaires imagos qui content à toute vitesse l’inatteignable et immobile aisselle.
Impossible ainsi d’oublier celle qui aura dansé pour moi durant des jours dans une chambre minable d’un hôtel meublé. Arrêter ça. Mais comment ? Éternels ces moineaux qui, depuis la rambarde du balcon, nous épiaient puis, dans un vol rapide, venaient chaparder les miettes brunes de pain bis abandonnées sur les draps de notre lit international ! Quel cinéma !
Nous habituer à ne vouloir rien devenir
Des idées nous ont tenté et nous tentent encor, des images et des actions→ naissances. Avons ainsi épuisé un bon nombre d’hypothèses dans l’intention d’agir ; naître et renaître toujours. Mais est-ce bien de cela dont il est question ? des hommes tombent, et dans nos livres s’amenuise doucement le souvenir de la raison des corps et des rendez-vous dans l’atmosphère au grain léger.
Parfois, par grand calme, réapparaît pourtant la poussière des saisons qui ornait les chemins, les gravières du Drac blanc, les rives de la Neste d’Aure ou celles du gave d’Azun, les prés où, durant l’été, allongés en plein soleil, nous rechargions de chaleur nos corps engourdis par la fraîcheur des baignades. Certes, nous fîmes bien peu cas des guerres, du malheur des hommes. Certes, derrière nos masques, dans les arômes de nos cabines corporelles, individuelles et insatisfaisantes, avons dormi d’un sommeil malade, la tête abîmée, farcie de rêves et couverte de fêlures. Quelques fois nous nous serons aussi tout de même battus pour essayer l’exil, rejoindre dehors un espace asilaire et subtil ; un lieu idéal et commun. Du reste, avons aimé sans que jamais ou presque l’instinct n’ait pu assombrir aucun de nos gestes. Et si lors de nos étreintes – le visage enfoui dans les voiles, les plis les plus intimes de l’être, la bouche embrassant et fouillant les muqueuses de velours et de musc d’où jaillissent des flopées d’étoiles, il ne fut pas tant cas de ruse du vouloir que de l’augural retour– , nos yeux, nez et langues ne cessèrent d’acclamer au périmètre des faces, ce qui en inondait les berges, la beauté et l’audace des crépitements, puis l’onction des émissions et leurs odeurs abondantes, envahissant notre désir fou et vain d’y pouvoir disparaître.
Coquillards enluminés de complaintes, n’ayant eu de cesse de nous déprendre, de nous éloigner du pays du père, des meutes – accomplissant à rebours des pratiques communes l’exubérant prodige de s’offrir quelques fraternelles solitudes -, on se filme pudiquement, sans caméra, avec la mort qui sait bien que l’on feint. Et on ne l’imagine pas – avec ou sans visage –, puisque nous la portons joyeusement, tournoyant et criant autour du rien, comme si l’on venait de naître.
Voilà. Déjà plus rien d’autre que la limpidité, l’air et les eaux de neige violaçant la peau, le vent aux lames froides balayant une voûte céleste au bleu luzien. Et nos simples figures tournées vers d’autres figures, d’autres corps, demandent au ciel de bien vouloir les accompagner. Car nous voulons nous étendre sous le ciel, et chanter en nous battant les lèvres avec les mains comme nous le faisions quand nous étions enfants ; entrer dans l’énonciation d’une langue étrange et complexe.
Compassion envers ceux qui réfuteront cet écoulement métamorphique du vivant.
Je ne le dis pour personne, cet espace de verre, hymne aux épaules sublimes. Ne rien craindre des railleries, des mépris. Ce qui nous ceint est un cœur sans durée. L’embrasser avec quoi : le texte → canto : aux paysages de pierres et d’herbe, d’évanescences claires et musicales du voyage intérieur. Mais c’est aussi dehors, montant vers l’épaule d’avril, par l’insaisissable échelle de splendeur, qu’il n’est plus lieu d’écrire. Y pourvoient déjà avec peine, les chapitres insaturés à doubles ou triples liaisons ; un peu mieux les primevères des talus jaunes et verts resurgissant sous le givre.
Mort, vois nos mains, nos inscriptions, entends notre souffle, il n’y a là-dedans rien qui puisse satisfaire tes masques.
Trop de travail sur la langue, pas assez d’écoute à l’égard du songe des signes et des légendes. Passé l’incrédulité, c’est-à-dire l’attention ahurie prêtée au déboulement sauvage d’une zébrure scindant soudainement le passage, il faudra du ciel et des corps se convaincre.
Il n’y eut pas d’année qui fixa mieux qu’une autre la permanence d’Ainsi. Averses de soleil et de nuit. Et nous, pauvres de nous, sommes venus plus d’une fois apposer souffle et lèvres sur des noms, des corps, des langages- corps, des histoires, et toujours on nous a sommé de révérer l’esprit du temps.
Ainsi _ prolifère là, sous la peau et non seulement dans l’idée, mais également par le corps craie, et pas uniquement par le corps craie, sa délicatesse tortueuse et bordée de pivoines et d’alouettes. Affleure par ce penchant pour les ciels et pour les corps qui dansent et chantent en frappant la terre des pieds. N’émerge point seulement de la terre ni seulement de la danse, mais aussi de toutes les époques cuites avec leur mémoire.
Abonde par la bouche intuitive, et non par la seule raison. Ni absolument par l’œil. Inonde mêmement le cœur, sa boîte noire et touffue, et non la seule gloire du souffle que la tétine du sommeil diminue jusqu’à l’amble et endort, mais bien sûr aussi par ce souffle que l’esprit sait rivière large et courbe dont le lit fomente le courage obscur d’enfants perles.
Ni dehors, ni dedans, mais dans la course immobile des temps, les corps translucides de l’enfance de l’aube ; dans ta bave et ta flore, à l’à-pic d’une rêverie létale où l’âme fait le choix de la terre et de l’eau, se passe de durée, vide flottant à plusieurs cœurs au sens parfait des principes du rêve et des substances fondamentales ; dans les signes s’évanouissant sans perte ; sous les aspersions de la lumière, bondissant vers les lacs d’Ayous, au printemps des gentianes, des orchidées, jonquilles, renoncules et des parterres d’airelles bleues ou des tapis de camarines ; dans les contrastes sylvains de verts sombres que les grands cheveux blancs et froids des cascades brumisent ; ou dans le Néouvielle, lorsqu’on grimpait jusqu’aux derniers spasmes supportables, soit d’un soléaire, soit d’un gracile qui finalement nous jetaient riant et jurant dans le délice de l’ombre d’un pin à crochets, passées les landines de genévriers nains et de raisins d’ours, et que nous n’existions ! et encor lorsque l’amour était partagé autour de gros morceaux de pain→eish la vie à pleine vinaigrette, et que la délicieuse salade de tomates était avalée et tout l’univers avec, et que le don ainsi ouvert, sa présence réelle, nous éloignait du souvenir.
Ainsi s’ouvre, multiplié. À tout de suite ! s’accomplit affecté, imparable. Toutes circonvolutions égales, et Ainsi de suite. On dort si près des rêves de l’autre déjà énoncés ; sèmes clairs et abstrus, corps lumière et tous les tableaux descendus jusqu’au sein de la langue, ses plis vocaux, et dans la chambre aux soies ciliées des cochlées électriques.
Ainsi renonce, plaide, perce, transperce, crève, démolit ; efface tout trace d’inquiétude tangible sur les pelouses, dans les arbres et les yeux aux iris verts de l’eau.
Ébruite l’insaisissable depuis un axe pyramidal, Kaïlash, jusqu’aux glacis de l’Ossau, verglas dans l’air vertical happant des ombres les bruits. Sans piété aucune sommes nombreux à n’en vouloir dire que l’enfance. Vidéo, je vois ; inadvertance primordiale ! sabayon luisant de tiges et brins ; pas grand-chose pour ainsi dire.
;indécidable, mal si pas serait n’ce
le souvenir heureux et guéri.
Assez de voix. Il faut entendre, doucement vivant. Ainsi très murmuré intercepte des douleurs les sonorités.
C’est Ainsi. L’impondérable dissémine sans cesse, et cela ne signifie rien.
Extrait de « Sans cesse » Editions TARMAC 2018
Image d’entête: travail personnel
.https://www.tarmaceditions.com/sans-cesse